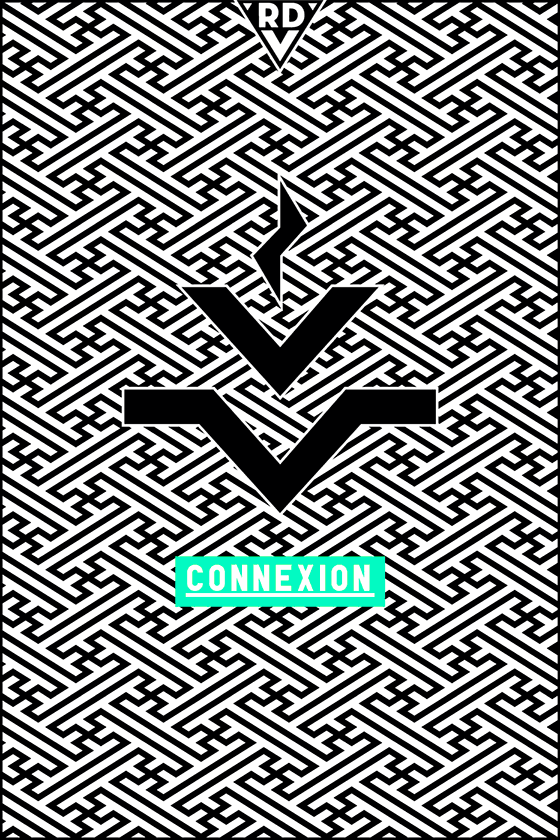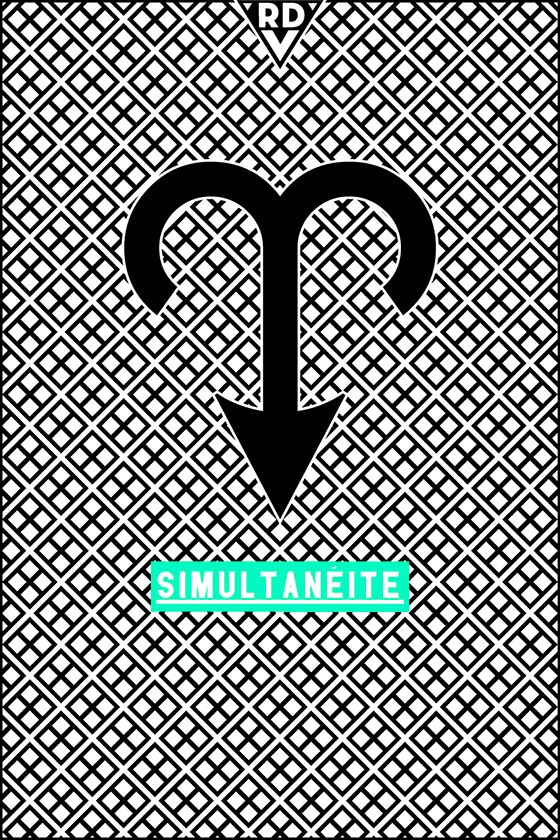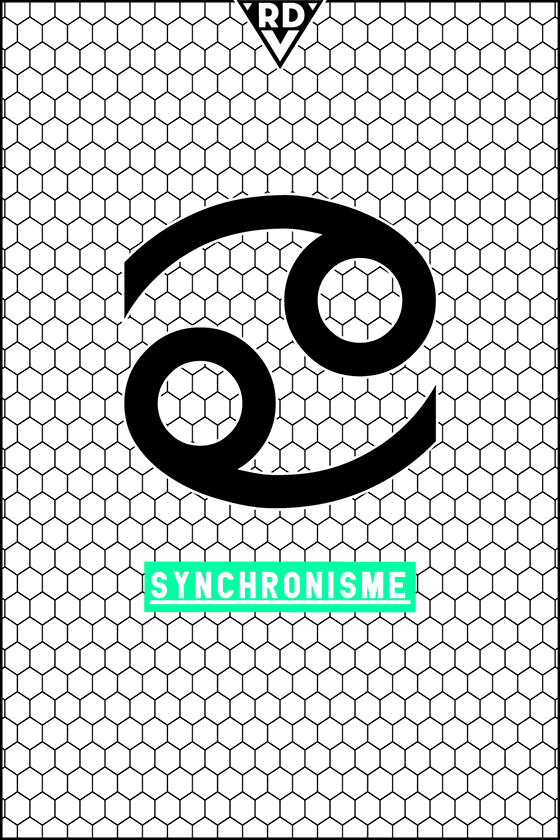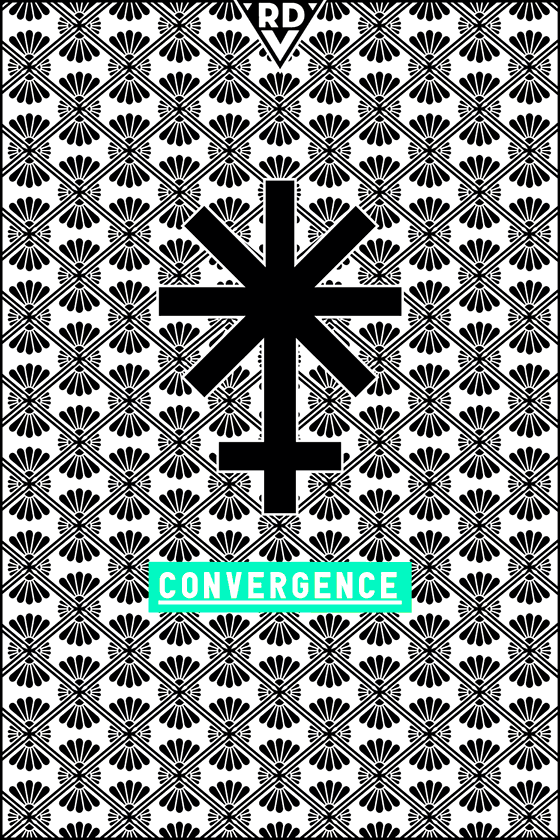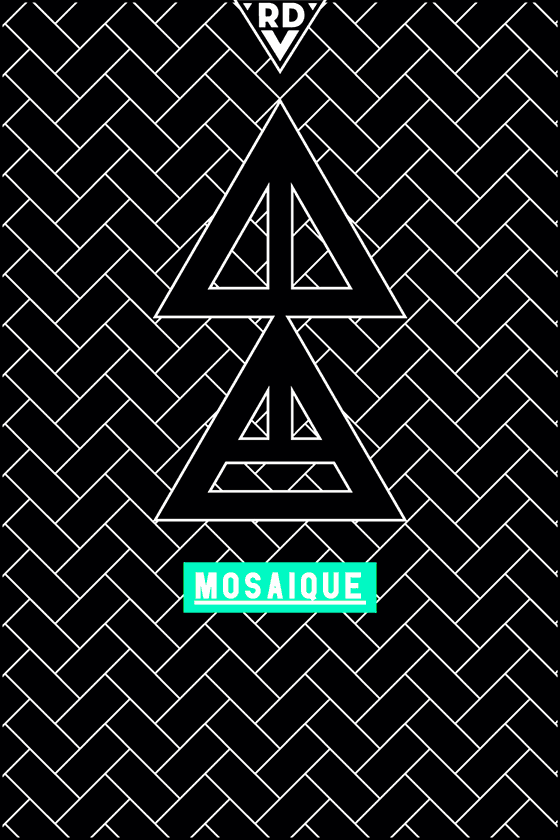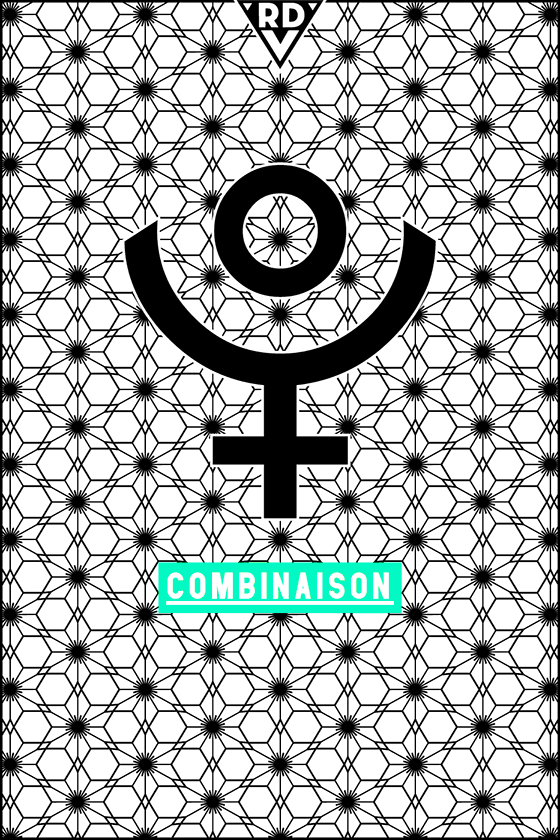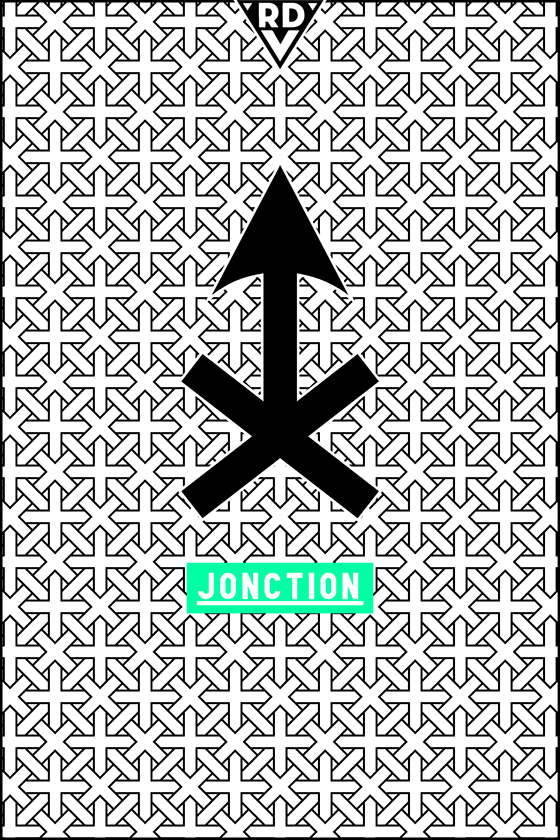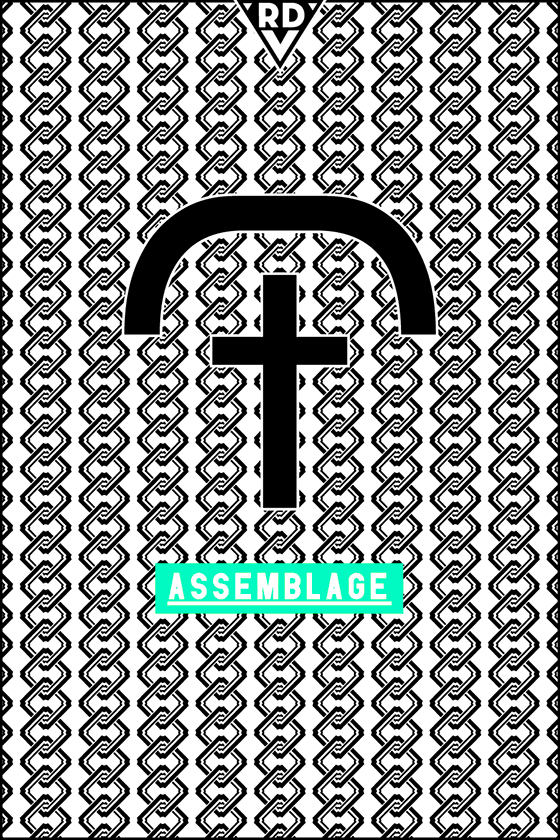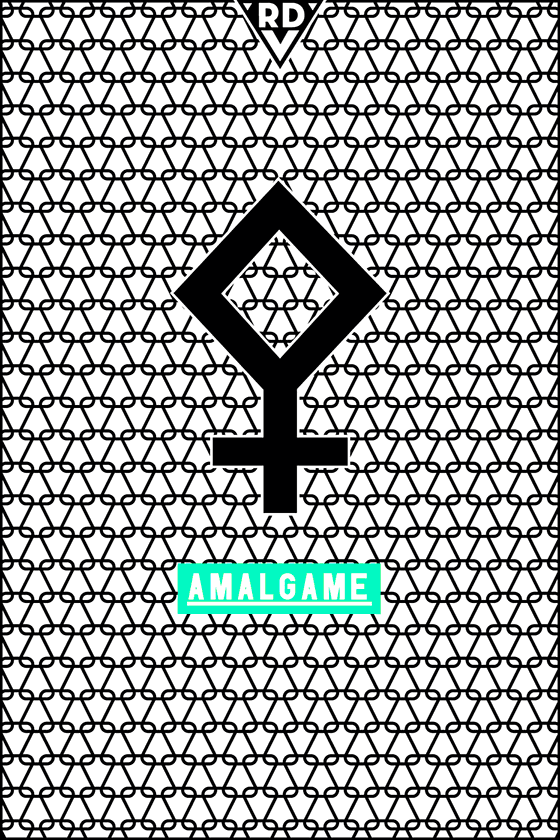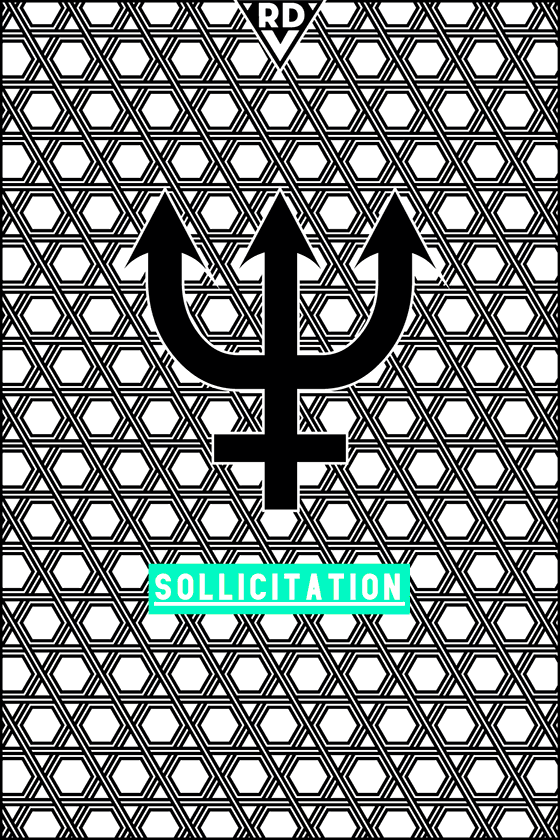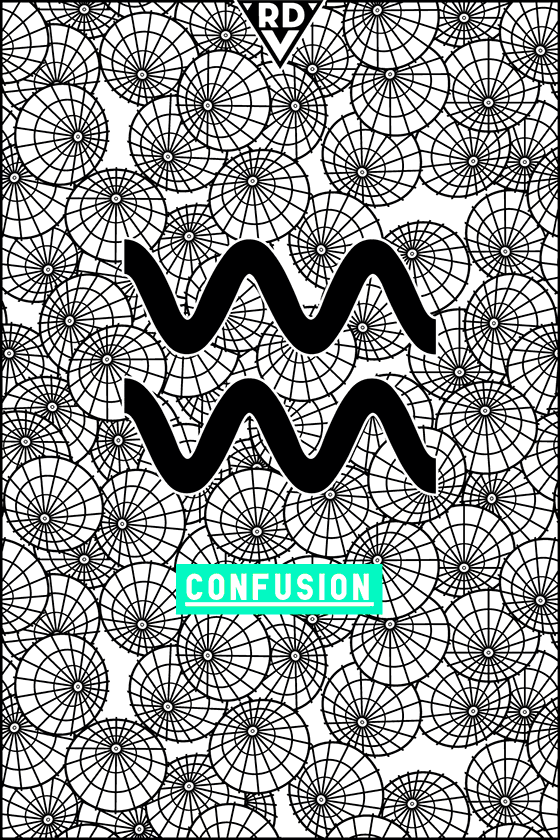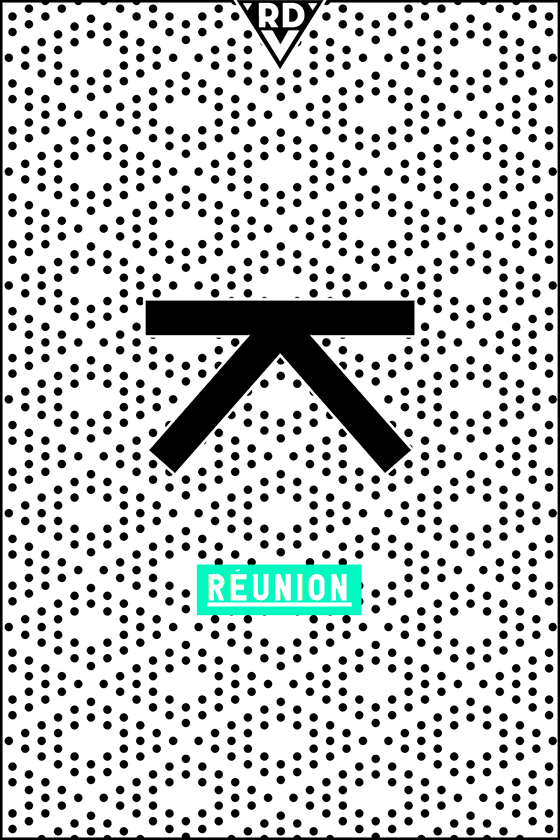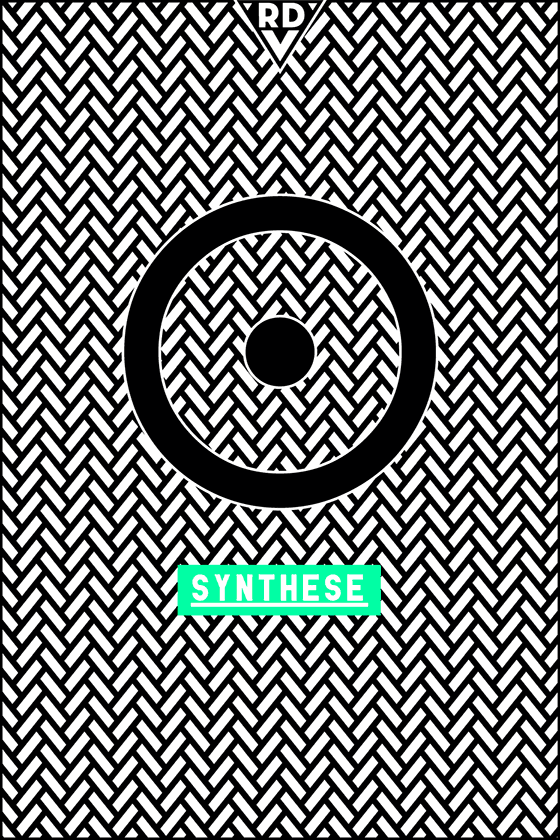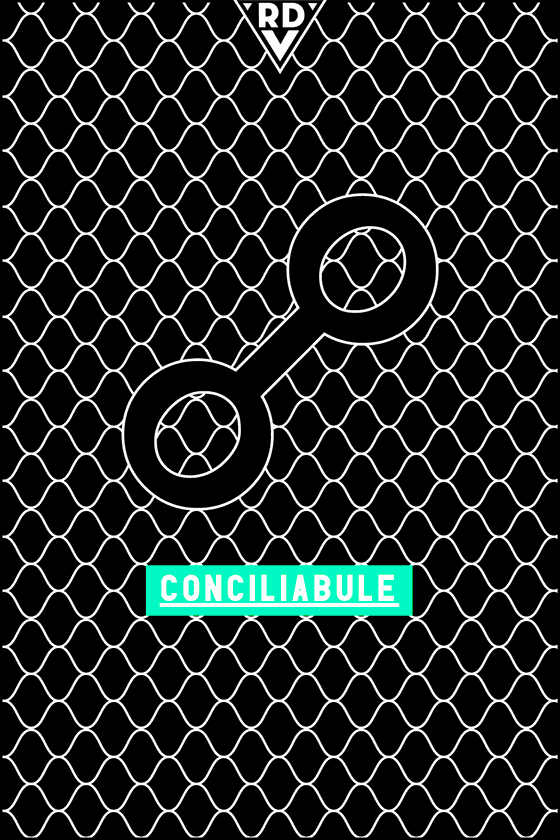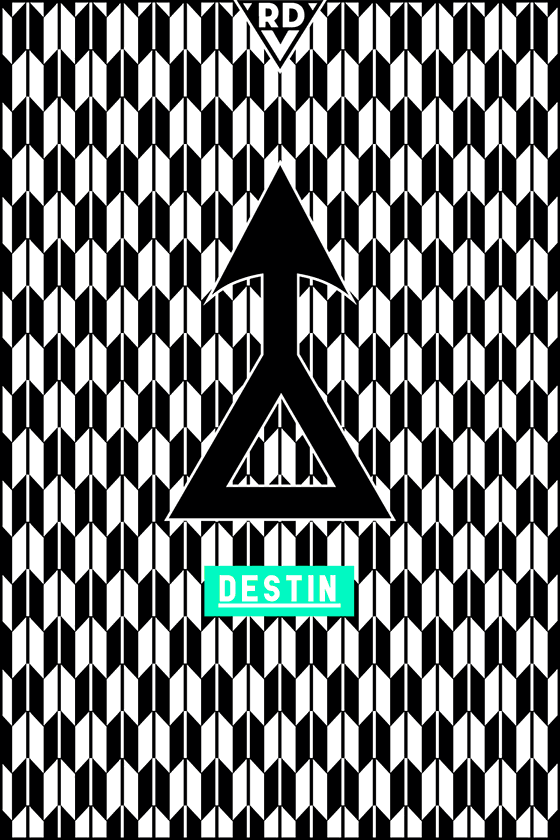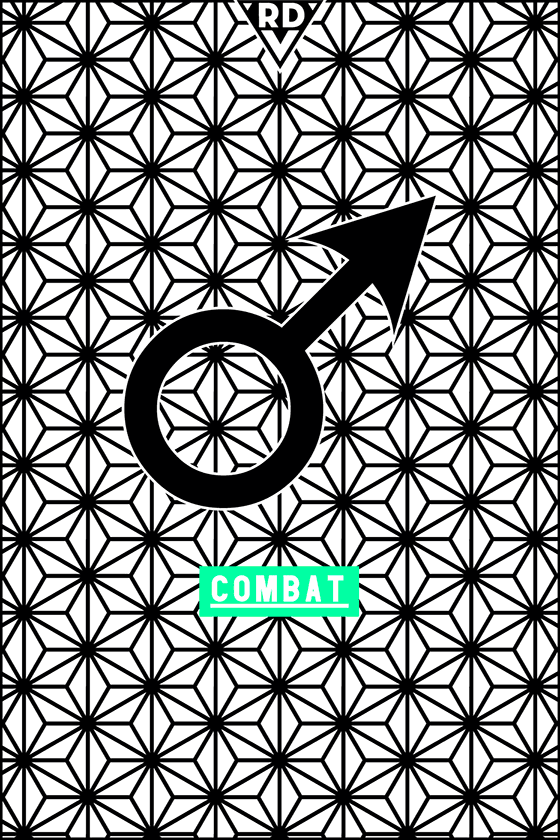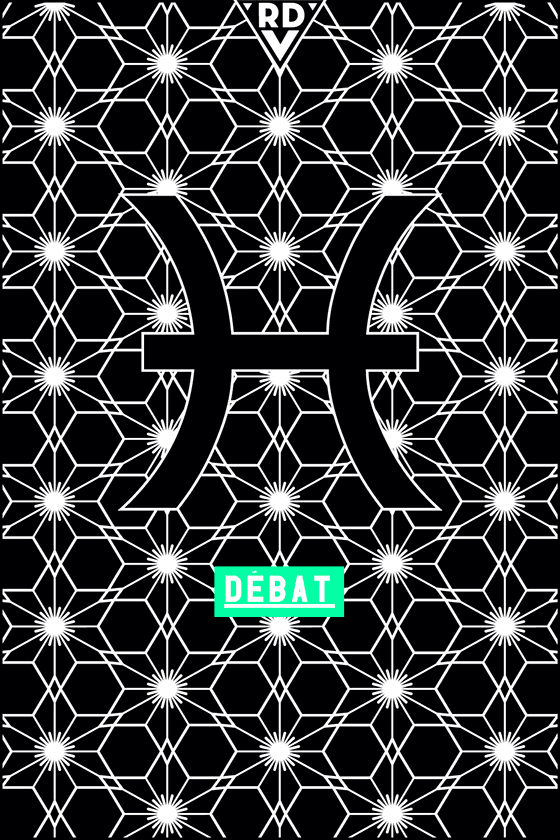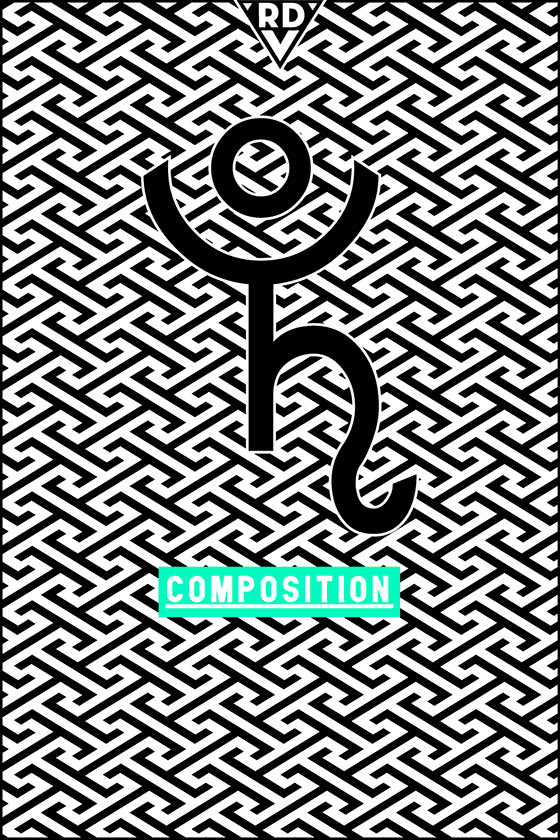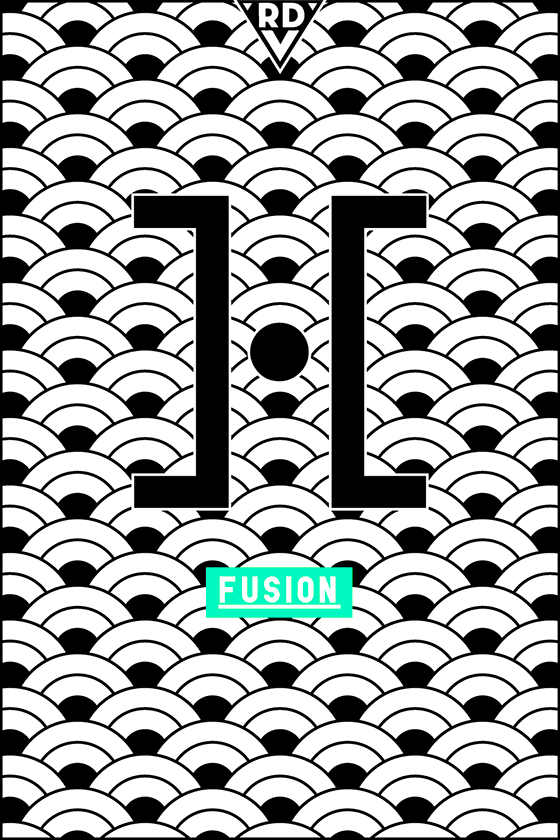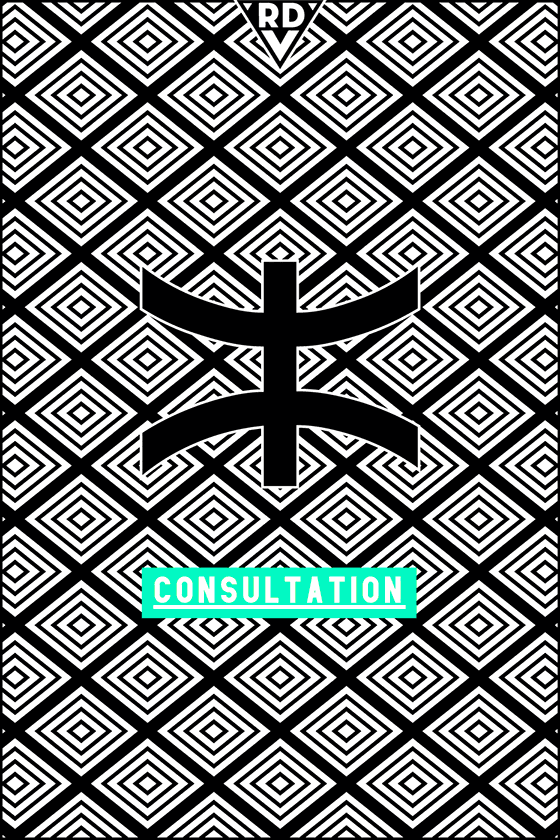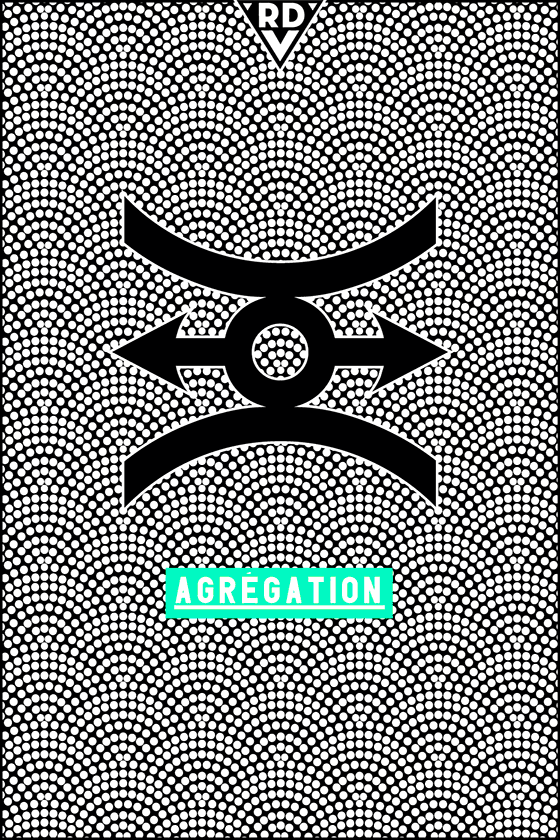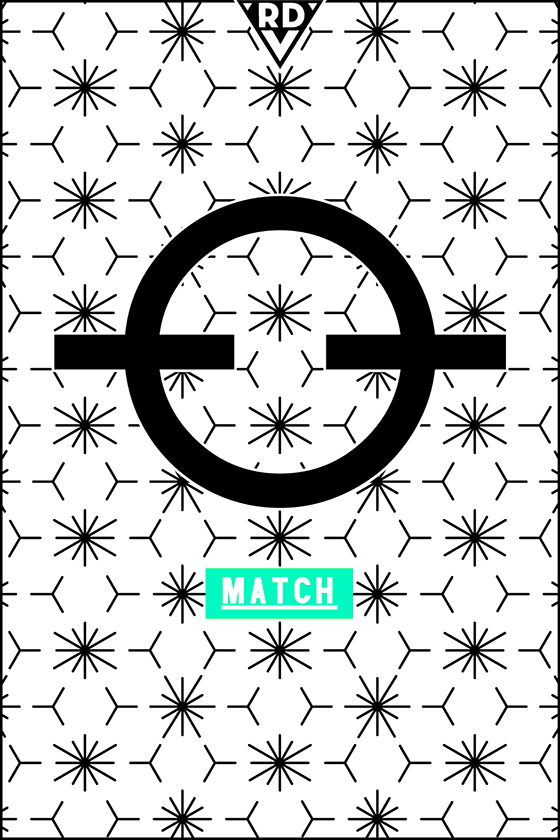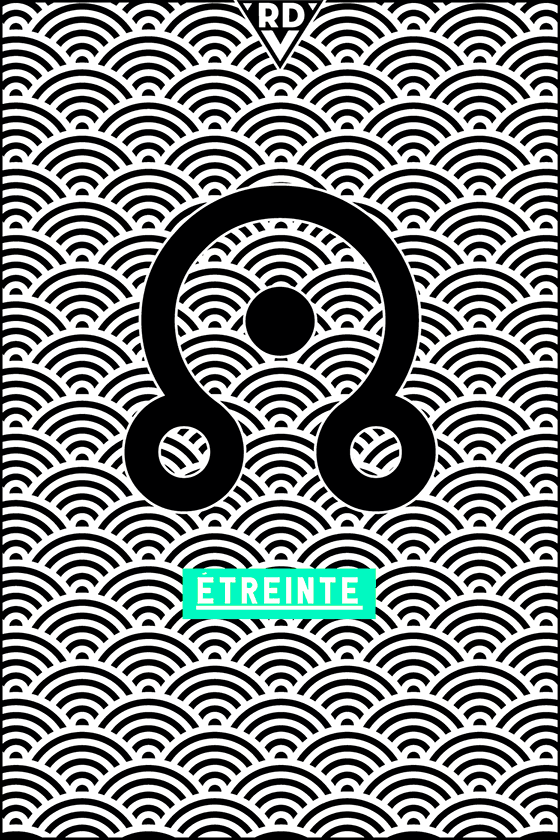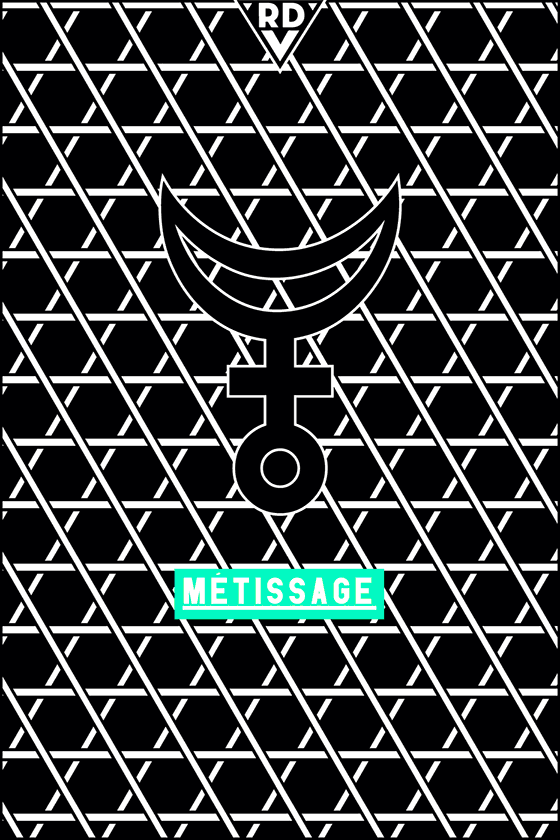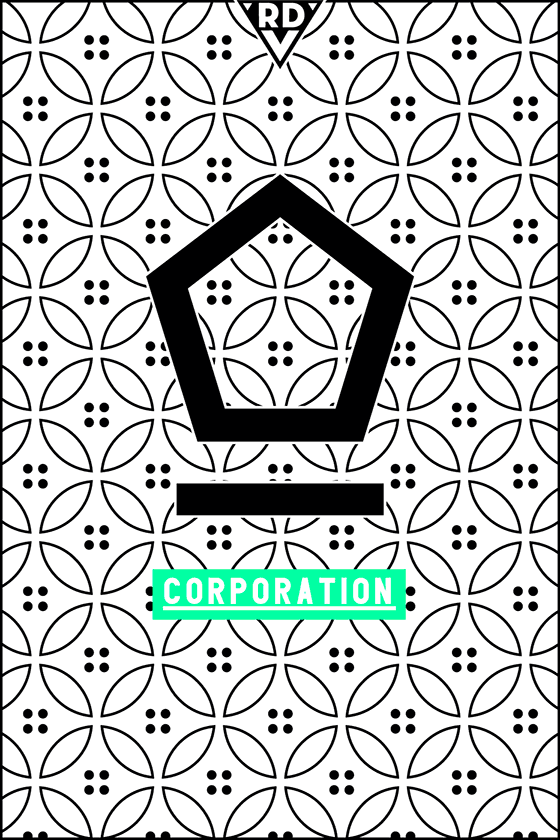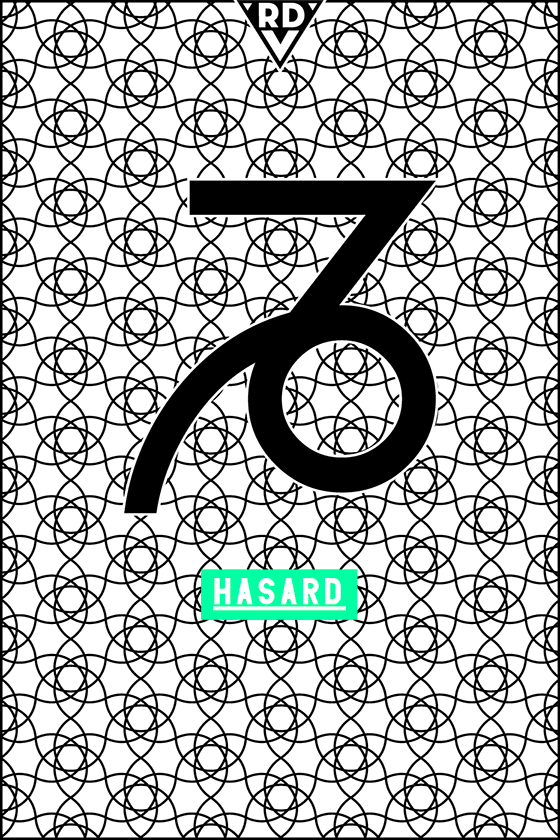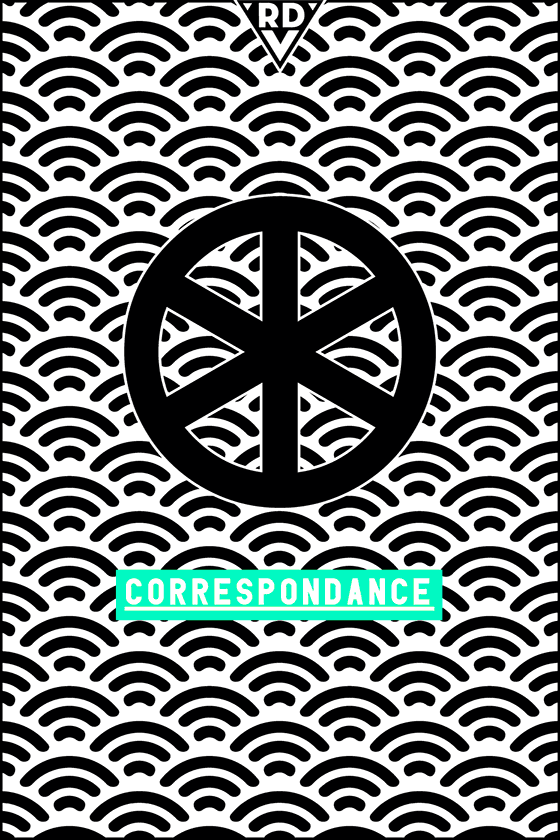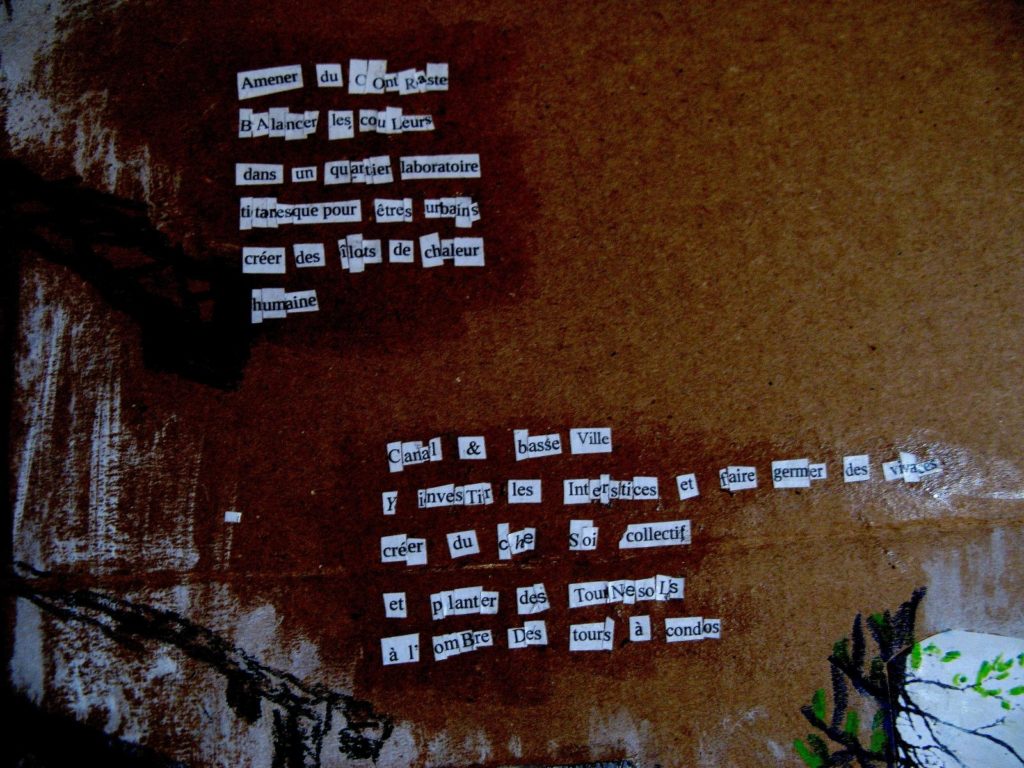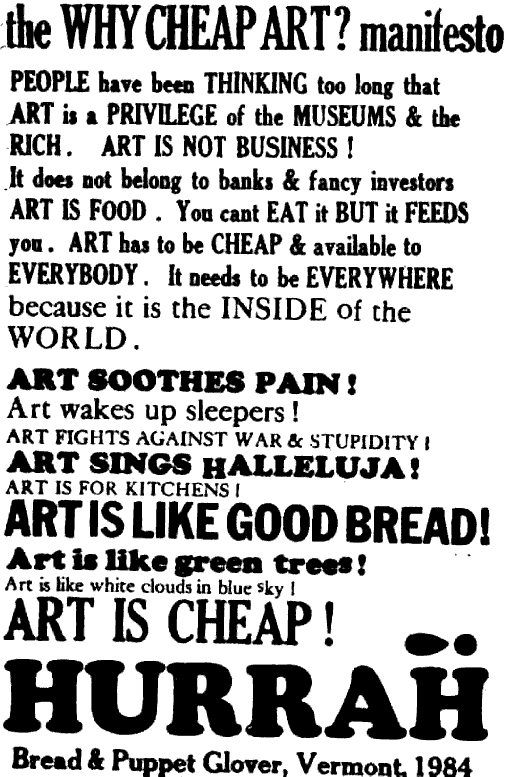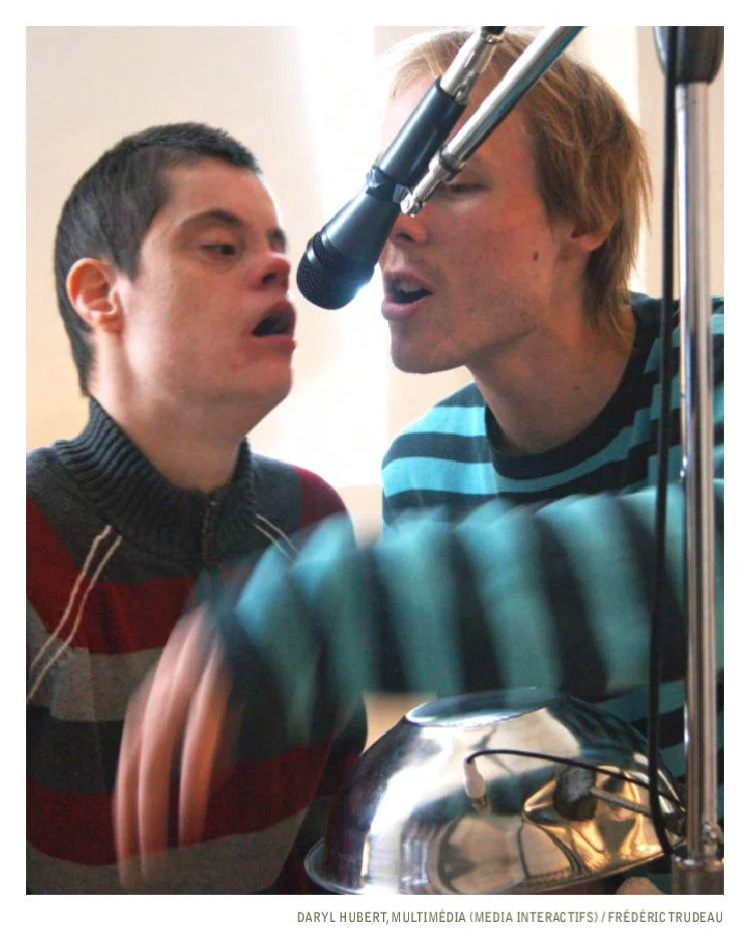Poste restante
Au départ, l’idée était bien simple. Lancée dans un élan d’enthousiasme et adoptée sur un coup de tête.
Partir à vélo, pour oublier un peu les courriels et les piles de vaisselle. Découvrir un coin de pays, sentir chaque kilomètres traverser notre corps. Nous retrouver pour quelques semaines, avec rien d’autre à faire que pédaler, un chez soi accroché au porte-bagage. Parcourir une route qui nous ramènerait à notre point de départ, plus légers.
Et puis il y a eu les listes de matériel à acheter, un budget à respecter et des règles de sécurité routière. Du coup, nous avons eu peur de nous empêtrer dans les détails techniques. Pour ne pas rater cette rencontre avec nous-mêmes, nous nous sommes fixé un rendez-vous quotidien.
Chaque soir, dans nos carnets respectifs, nous avons écrit les réflexions, les souvenirs, les images qui nous habitaient pendant la journée. Pour garder une trace, mais surtout pour nous donner la chance de parodier les incidents, de romancer les anecdotes les plus banales. Un peu aussi pour pouvoir partager, bien humblement, quelques passages de cette aventure gaspésienne sur deux roues.
En relisant nos carnets, nous avons choisi sept journées. Sept paires de fragments qui se font écho d’une manière singulière. Des textes qui posent des regards différents sur des instants communs et que nous avons accompagné d’images fantaisistes.

Le Bic – 8 juillet 2013
Ce matin, alors que tu dormais toi-même dans l’autobus entre Lévis et le Bic, une vieille dame assise sur la banquette à côté de nous s’est réveillée brusquement. En sursautant, elle a laissé échapper un bref cri apeuré, puis a vite constaté son ridicule. Elle s’est excusée timidement (en anglais), puis a cru bon de se justifier : « Oh! I’m so tired! ». En cette fin d’après-midi, alors que nous écrivons côte à côte devant la Baie du Ha! Ha!, je pense à tous ces « Ha! », ces « Oh! », ces exclamations soudaines tirées du grand lexique atavique. Du cri de terreur d’un méganticois pris par surprise dans le brasier de sa ville aux rires enjoués de deux voyageurs à la veille d’un départ.
Jean-Philippe
À Lévis, la gare d’autobus est une succursale de Pétro Canada. J’étais déstabilisée : les caissières adolescentes et les publicités de Budweiser dans les fenêtres me paraissaient indignes de l’aventure dans laquelle nous étions sur le point de nous lancer. Au moins, les bourrasques qui balayaient le stationnement avaient une odeur de départ. Le chauffeur n’a pas bronché en nous voyant enfoncer dans la soute nos vélos maladroitement emballés. Pas de regard intrigué, pas de sourire amusé. Décidément, nous n’étions pas les premiers. L’autocar était rempli d’inconnus assoupis dans leur capuchon; c’était le silence complet, à l’exception de nos rires surexcités qui s’emballaient pour la moindre raison. Comme si nous étions deux enfants investis d’une mission qui tient tout son charme dans le secret.
Camille

Ste-Flavie – 10 juillet 2013
Aujourd’hui, j’ai craint d’avoir manqué le rendez-vous. Je pédalais une vingtaine de mètres derrière toi, sur un faux plat interminable, quelque part entre Le Bic et Rimouski. Le souffle et les muscles me manquaient pour te rattraper. Je te voyais me regarder sans cesse par-dessus ton épaule, mais les rayons de soleil réfléchis sur l’asphalte m’empêchaient de lire ton visage. Dans le doute, je pouvais supposer ton impatience, tes encouragements, tes inquiétudes. Pour la première fois depuis notre départ, je me suis sentie seule. Seule contre la distance et les dénivelés, sur ce vélo qu’uniquement ma force pouvait faire avancer.
Camille
Tu ne l’as pas connue. Tu sais qu’elle a marqué ma vie. Le verbe est trop fort… Tu sais en tous cas qu’elle est passée dans ma vie. C’est d’ailleurs en passant sur la route du fleuve, à Ste-Luce-sur-Mer, que j’ai pensé à elle. Je voulais te montrer le minuscule chalet où elle m’avait accueilli pour quelques jours, un été, il y a peut-être quatre ou cinq ans. En vain. Malgré le souvenir très clair que j’avais gardé de sa maison mobile blanche en bordure du fleuve, je n’ai rien trouvé à te montrer. Peut-être en va-t-il ainsi des maisons mobiles… Certains jours de grand vent, peut-être décident-elles de prendre le large. Et les amies disparues, que deviennent-elles ? Je pense à Suzette et à défaut de pouvoir te la présenter, je te parle d’une maison disparue.
Jean-Philippe

St-Siméon-de-Bonaventure – 16 juillet 2013
Le chalet que nous avons loué semble figé au début des années 90. Télévision cathodique surdimensionnée; sofa en velours gris-bleu; meuble multifonctions en mélamine. Ce décor, aidé par les verres de vin, nous replonge dans cette décennie révolue, époque de mon enfance et de ton adolescence. Les équipes d’impro, les cours de piano, les vacances en famille, les défunts animaux de compagnie. Tout nous revient en vrac, sans doute magnifié par le temps. Au moins, l’euphorie des vacances nous tient loin des souvenirs amers. Ce soir, la nostalgie est faite de fou rire; nous retenons les royaumes imaginaires et oublions les insultes de cafétéria. Quand même, au moment de m’endormir, ton corps assoupi contre le mien me rappelle le bonheur d’être adulte.
Camille
Nous redécouvrons lentement l’art de la flânerie. Nos vélos, bêtes de somme dans les derniers jours, sont redevenus d’agiles petits véhicules de promenade. Nous gardons encore certains réflexes de routards et mesurons le kilométrage effectué entre le chalet et l’épicerie. Mais notre pédalage a changé. Il est déjà plus désinvolte, moins économe. Il nous arrive de mouliner dans le vide et de faire tanguer le guidon à gauche, à droite, simplement pour garder l’équilibre. Nos préoccupations sont aussi moins rigides, moins dictées par les paramètres de la route à faire. Dénivelés, vents dominants, ravitaillement ne font presque plus partie de nos discussions. Nous parlons de tout, de rien, mais surtout d’autres choses.
Jean-Philippe

St-Siméon-de-Bonaventure – 19 juillet 2013
Au fin fond de la route Poirier, nous redécouvrons un sentiment qui nous était devenu étranger: l’attente. Dans un chalet sans téléphone, nous attendons des amis qui n’en ont pas non plus. Sur le balcon, le nez dans nos lectures respectives, nous faisons de notre passion un passe-temps. De temps à autre, nous percevons le grondement d’un véhicule. Chaque fois, je lève les yeux discrètement, feignant de me concentrer sur mon roman.
Après quelques heures, je te demande :
– Ça ne te stresse pas, toi, de ne pas savoir exactement quand ils vont arriver?
– Pas du tout, je suis absorbé par mon roman.
Tout à coup, un moteur plus bruyant que les autres. Tu remarques « Ça ne peut pas être eux. Ça ressemble plus à un quatre-roues. » Je souris, rassurée de te trouver avec moi dans cette incertitude qui pousse les sens en alerte.
Camille
Quelques jours de sédentarité auront suffit à nous donner l’illusion d’être chez nous. Cette habitation nous a rendus nous-mêmes plus solides en nos fondations. C’est entourés de nature, comme depuis le début, mais à l’abri, que nous avons lentement dénoué nos muscles endoloris, que nous nous sommes débarrassés de nos peaux mortes, que nous avons laissé le temps passer tranquillement, comme le flot paresseux de la petite rivière St-Siméon. Et pour mieux partager le plaisir de cette nonchalance, nous avons choisi d’ouvrir notre porte à des amis. Ils se sont aussi sentis chez eux. Avec nous, ils ont aussi laissé le temps faire son œuvre sans plus d’occupation que la veille insouciante de nos besoins immédiats.
Jean-Philippe

Percé – 22 juillet 2013
Les touristes sont généralement laids. Ils aiment les choses laides qui évoquent de belles choses : un bibelot en céramique qui reproduit en miniature le profil immense d’un cap rocheux ou un coton ouaté gris à l’effigie d’un fou de bassan. Les touristes se déplacent dans des véhicules immondes : des châteaux roulants qui traînent derrière eux des chars d’assaut pour les déplacements légers. Aujourd’hui, nous sommes arrivés dans la petite boule à neige en verre de la Province et nous avons su garder la tête haute. Nous avons joué aux touristes, mais avec l’arrogance chauvine de deux locaux. Ou presque. Nous ne sommes que de passage, mais avons conquis chaque kilomètre de route qui nous a menés jusqu’ici. Ces kilomètres de route nous appartiennent et notre bronzage nous rend beaux. Rien à voir avec les grosses faces rougeaudes de tous ces touristes.
Jean-Philippe
Percé, c’est Old Orchard, c’est Key West. C’est n’importe quelle ville du monde où on trouve des magasins de bibelots à tous les coins de rue, mais pas de quincaillerie. C’est l’authenticité résumée par des homards géants en plâtre. Percé, c’est des milliers de sourires niais avec une roche trouée en arrière-plan. Au moins, nous avons trouvé un restaurant presque vide où le serveur n’était pas déguisé en capitaine de bateau. Autour d’une morue poêlée et d’un demi-litre de vin blanc, nous avons discuté sans effort de choses banales, fascinantes, spirituelles, délirantes. Nous avons ri des autres, du kitsch ambiant, mais surtout de nous-mêmes. Et en marchant pour retourner à notre terrain de camping, un peu malgré nous, nous nous sommes arrêtés pour admirer le rocher. Avec un coucher de soleil, pour le cachet.
Camille

Douglastown – 25 juillet 2013
À Douglastown, les numéros civiques ne sont pas indiqués sur les maisons. Nous devinons le 6 rue Trachy grâce à son drapeau du Québec qui jure dans ce petit village irlandais. Sur la voiture stationnée dans l’entrée, l’autocollant d’un concessionnaire montréalais nous confirme que nous sommes bel et bien au bon endroit. La porte est ouverte; juste à côté, un vieux coton ouaté, un bas de pyjama et un chapeau en feutre sont cloués sur la façade en bardeaux de cèdre, imitant la position du Christ sur sa croix. Comme si quelqu’un, ici, avait voulu mourir pompeusement. J’appelle mon amie à travers la moustiquaire. Sans réponse. Je me permets d’entrer et découvre un fouillis sans nom. Des artefacts accumulés sur les moulures, des affiches de bière et des toiles abstraites affichées côte à côte, des mots d’amour et des versets bibliques griffonnés au plafond. Un décor surchargé qui porte la marque de nombreuses années d’existence : de soirées arrosées, d’amours déçus, de nouvelles rencontres et d’amitiés rompues. L’odeur, un mélange de poussière, de cigarette et de fleurs séchées, réveille en moi cette mélancolie que j’ai facile. Quand je ressors, au bout de quelques minutes, tu me demandes : « Et puis, c’est comment? » Je reste silencieuse, ne trouve pas de mots assez vastes pour tout nommer. « Rentre. Tu verras par toi-même. »
Camille
À vitesse de voiture, le profil des côtes s’adoucit, les nuances de la route s’estompent, les paysages deviennent un peu plus flous. Ce n’est qu’à vitesse de jambes, qu’on peut vraiment apprécier les subtiles variations du territoire : certains villages où la peinture des bicoques s’écaille davantage, certaines montées plus impitoyables, certains vents plus imprévisibles. À mesure que nous avançons, nous nous laissons traverser, il me semble, par une multitude d’expériences diverses qui nous transforment, qui nous inspirent ou, à tout le moins, nous alimentent. Quand je retourne consciencieusement au tracé des courbes topographiques, j’aime à penser que cette ligne brisée irrégulière est une sorte de trace abstraite de notre propre évolution. Tel point correspondant à un moment de découragement dans une montée, tel autre à un moment d’oubli de soi dans une descente. Un autre encore marquant l’instant précis d’un rire sonore dans une maison excentrique de Douglastown…
Jean-Philippe

Mont-Louis – 1er août 2013
Aujourd’hui, j’ai pêché mon premier poisson. Ça n’avait rien d’un exploit : paraît qu’on attrape les maquereaux par dizaines, à cette période-ci de l’année. Mais pour nous, c’était une aventure. Sur la clôture défoncée du quai désaffecté, l’inscription « Interdit de circuler » nous rendait déjà fébriles. Et puis, simplement d’être là, au milieu des pêcheurs locaux, avec l’odeur de varech, c’était suffisant. Assez pour faire de ce moment un souvenir. Quand quelque chose s’est agité au bout de ma ligne, j’ai essayé de cacher mon excitation. Toi, tu as jubilé pour deux. Tu as emprunté un cellulaire au hasard pour me photographier, le sourire figé et une prise pendouillant au bout de ma canne à pêche. Nous ne reverrons sans doute jamais cette image et n’en avons rien à faire. Si ça se trouve, j’ai les yeux fermés et ton doigt sur l’objectif cache la moitié de mon visage.
Camille
C’est presque à notre insu que nous avons traversé les terribles côtes de la Madeleine pour aboutir dans ce havre hippie et chaleureux. Au fil d’arrivée, nous attendaient des jeunes gens dont on ne sait trop s’ils avaient lu Thoreau à la lettre ou s’ils avaient simplement envie de faire le vide le temps d’un été. Étrange retour en société que cette incursion dans l’utopie de Mont-Louis. Comme un condensé de tout ce que peut représenter la Gaspésie pour qui chercherait à se réinventer. Et nous, dans tout ça, avons-nous grandit de cette traversée ? Quelque chose me dit que ce n’est pas dans la bière du Sea Shack que nous trouverons notre réponse. Mais peut-être plutôt dans les regards complices que nous échangerons désormais lorsque nous penserons à ce périple gaspésien.
Jean-Philippe